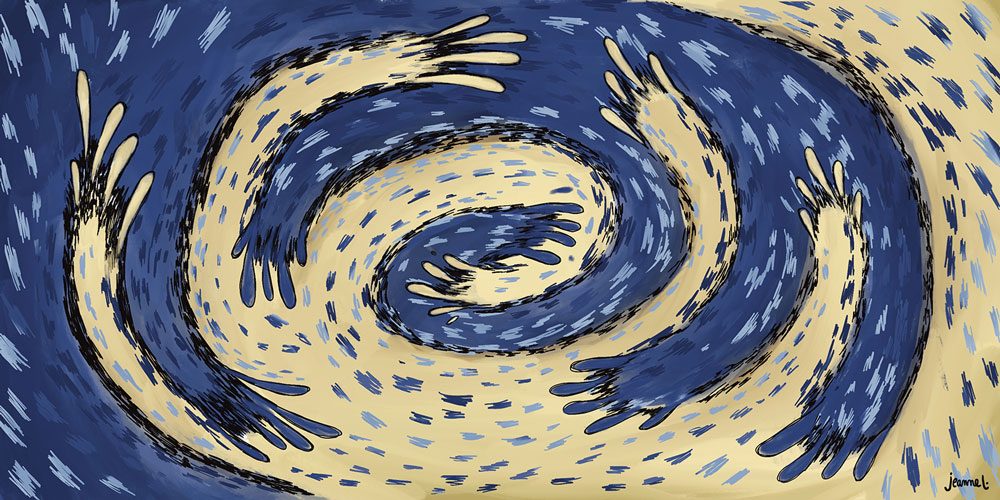Mise à jour le 24 nov. 2025
Publié le 19 novembre 2025 – Mis à jour le 24 novembre 2025
par Mireille Losco-Lena, professeure en études théâtrales, Laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI), ENSATT
La recherche-création (Practice-as-Research) s’est développée en France ces dix dernières années et elle fait l’objet de nombreuses réflexions et de vifs débats aux niveaux national et international. À l’heure actuelle, sa définition reste fluctuante et multiple, car il s’agit encore d’un champ en construction, mais prometteur.
Travailler à l’élaboration d’un nouveau champ de recherche est une aventure passionnante mais ardue, parce qu’elle exige de penser des épistémologies qui peuvent heurter les convictions que nous avons de ce qu’est une recherche validable dans le monde universitaire. L’émergence, récente en Europe, de la recherche‑création constitue un défi en ce qu’elle nous invite à construire une façon inédite d’envisager la recherche.
Les Accords de Bologne sont à l’origine de cette émergence : avec la création, en 2010, de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et du « LMD » (Licence Master Doctorat) imposant l’harmonisation de l’ensemble des formations supérieures, les cursus de création artistique ont dû s’adapter au format du master. Il leur fallait dès lors définir le type de recherche auquel elles proposaient une formation. Le débat et les querelles ont été vifs.
Est-ce que les artistes doivent se soumettre à l’objectivité requise dans la recherche dite « scientifique » ? Faut-il penser la recherche-création sur le modèle de la recherche en ethnologie et en anthropologie, qui font une place à la dimension subjective dans leur épistémologie ? Est-ce que l’artiste doit intégrer dans son processus de création une ou des méthodologies rigoureuses, tels des protocoles de travail ? N’est‑ce pas là risquer de dénaturer la logique de la création artistique, faite de tâtonnements et de sérendipité ?
Le débat bat en brèche toute tentation de paresse ou de conservatisme épistémologique : la recherche-création ne peut pas être une « recherche et création », soit un acte de création artistique qui se doublerait d’un travail scientifique. Le trait d’union entre les deux mots exige au contraire de penser les connexions possibles entre deux mondes. Mais il faut pour cela travailler avec rigueur et honnêteté, en dépliant patiemment tous les problèmes épistémologiques qui se posent.
Le trait d’union entre les deux mots exige au contraire de penser les connexions possibles entre deux mondes. Mais il faut pour cela travailler avec rigueur et honnêteté, en dépliant patiemment tous les problèmes épistémologiques qui se posent.
Un point d’épistémologie est particulièrement important : en recherche-création, il n’y a pas de coupure entre le chercheur ou la chercheuse et l’objet de sa recherche. Contrairement à la recherche sur l’art, où l’on se met à l’étude d’un objet existant (une oeuvre, un courant artistique, un processus de création etc.) sur lequel on peut veiller à conserver une posture objective, le chercheur ou la chercheuse en art doit faire advenir une oeuvre. Son travail porte sur un objet qui n’existe pas encore et dont il n’est pas possible de se « couper » puisqu’il s’agit de sa propre production.
La façon de s’investir dans la création est d’autant moins objective qu’y entrent en jeu son imaginaire et ses émotions – ce qu’on peut appeler le « régime nocturne » de la pensée. Les « protocoles » de travail de l’artiste ne doivent pas faire croire en la scientificité de sa démarche : ce mot, aujourd’hui courant dans les arts, est avant tout métaphorique.
 La recherche-création se définira donc moins comme une démarche scientifique appliquée à la création que comme l’affrontement et la résolution, par l’artiste au travail, de problèmes, d’obstacles ou d’impensés de son domaine. L’artiste en recherche-création est un ou une artiste qui a rencontré, pendant sa formation et/ou son parcours, des limites aux savoir‑faire, aux procédures, aux cadres de pensée de ce qu’est la pratique de son champ de spécialité. C’est sa décision de prendre du temps pour explorer et trouver des gestes et des façons de penser qui vont lui permettre de franchir ces limites, d’en déplacer les cadres, concrets, techniques ou conceptuels.
La recherche-création se définira donc moins comme une démarche scientifique appliquée à la création que comme l’affrontement et la résolution, par l’artiste au travail, de problèmes, d’obstacles ou d’impensés de son domaine. L’artiste en recherche-création est un ou une artiste qui a rencontré, pendant sa formation et/ou son parcours, des limites aux savoir‑faire, aux procédures, aux cadres de pensée de ce qu’est la pratique de son champ de spécialité. C’est sa décision de prendre du temps pour explorer et trouver des gestes et des façons de penser qui vont lui permettre de franchir ces limites, d’en déplacer les cadres, concrets, techniques ou conceptuels.
La recherche-création peut également s’allier aux sciences, et particulièrement aux sciences humaines – même s’il ne s’agit nullement de s’y substituer ni de les concurrencer, car elle n’obéit pas au régime de la vérité objective et rationnelle propre à la science.
La création artistique constitue plutôt, dans ce cas, un apport expérimental et heuristique, en faisant émerger des idées et des pistes. Elle éclaire alors différemment des études de cas ou des terrains ; elle en trouble ou en opacifie les clartés théoriques pour relancer des questionnements ; elle permet de travailler sur les obstacles épistémologiques inhérents à toute science (Bachelard, 2004).
Si elle donne à penser autrement, c’est fondamentalement parce qu’elle renoue avec l’entièreté de nos identités de chercheurs et chercheuses. Comme l’écrit Michel Bitbol (2016), « les chercheurs scientifiques rêvent de contourner leurs corps, ou de les rendre pour ainsi dire transparents », alors que le corps participe pourtant de nos gestes et procédures de recherches, y compris les plus abstraits.
La recherche‑création conteste la fiction, propre à la science moderne, du « cerveau-dans-un-bocal » (Latour, 2007), qui forge un langage capable de dire le monde sans reconnaître toute la chaîne, hétérogène et inventive, du travail qui permet aux chercheurs et chercheuses de passer du monde aux mots, et qui les lie étroitement à ce monde.
 Avec la recherche-création, une chance nous est donnée de repenser la recherche sur un mode plus réaliste, en n’escamotant plus nos relations et notre appartenance au monde, et en reconnaissant les moteurs existentiels, affectifs, engagés, corporels, intimes et politiques, de nos travaux – moteurs sans lesquels nous serions, tout simplement, incapables de les produire et de leur donner un sens.
Avec la recherche-création, une chance nous est donnée de repenser la recherche sur un mode plus réaliste, en n’escamotant plus nos relations et notre appartenance au monde, et en reconnaissant les moteurs existentiels, affectifs, engagés, corporels, intimes et politiques, de nos travaux – moteurs sans lesquels nous serions, tout simplement, incapables de les produire et de leur donner un sens.
Recherche-création n’est pas recherche + création
Est-ce que les artistes doivent se soumettre à l’objectivité requise dans la recherche dite « scientifique » ? Faut-il penser la recherche-création sur le modèle de la recherche en ethnologie et en anthropologie, qui font une place à la dimension subjective dans leur épistémologie ? Est-ce que l’artiste doit intégrer dans son processus de création une ou des méthodologies rigoureuses, tels des protocoles de travail ? N’est‑ce pas là risquer de dénaturer la logique de la création artistique, faite de tâtonnements et de sérendipité ?
Le débat bat en brèche toute tentation de paresse ou de conservatisme épistémologique : la recherche-création ne peut pas être une « recherche et création », soit un acte de création artistique qui se doublerait d’un travail scientifique.
 Le trait d’union entre les deux mots exige au contraire de penser les connexions possibles entre deux mondes. Mais il faut pour cela travailler avec rigueur et honnêteté, en dépliant patiemment tous les problèmes épistémologiques qui se posent.
Le trait d’union entre les deux mots exige au contraire de penser les connexions possibles entre deux mondes. Mais il faut pour cela travailler avec rigueur et honnêteté, en dépliant patiemment tous les problèmes épistémologiques qui se posent.Intégrer le régime nocturne de la pensée
La façon de s’investir dans la création est d’autant moins objective qu’y entrent en jeu son imaginaire et ses émotions – ce qu’on peut appeler le « régime nocturne » de la pensée. Les « protocoles » de travail de l’artiste ne doivent pas faire croire en la scientificité de sa démarche : ce mot, aujourd’hui courant dans les arts, est avant tout métaphorique.
La démarche de la recherche-création
 La recherche-création se définira donc moins comme une démarche scientifique appliquée à la création que comme l’affrontement et la résolution, par l’artiste au travail, de problèmes, d’obstacles ou d’impensés de son domaine. L’artiste en recherche-création est un ou une artiste qui a rencontré, pendant sa formation et/ou son parcours, des limites aux savoir‑faire, aux procédures, aux cadres de pensée de ce qu’est la pratique de son champ de spécialité. C’est sa décision de prendre du temps pour explorer et trouver des gestes et des façons de penser qui vont lui permettre de franchir ces limites, d’en déplacer les cadres, concrets, techniques ou conceptuels.
La recherche-création se définira donc moins comme une démarche scientifique appliquée à la création que comme l’affrontement et la résolution, par l’artiste au travail, de problèmes, d’obstacles ou d’impensés de son domaine. L’artiste en recherche-création est un ou une artiste qui a rencontré, pendant sa formation et/ou son parcours, des limites aux savoir‑faire, aux procédures, aux cadres de pensée de ce qu’est la pratique de son champ de spécialité. C’est sa décision de prendre du temps pour explorer et trouver des gestes et des façons de penser qui vont lui permettre de franchir ces limites, d’en déplacer les cadres, concrets, techniques ou conceptuels.Pour que ce travail soit pleinement de la recherche – permettant d’être validée par des diplômes par exemple –, il faut encore que ses résultats soient reproductibles et transmissibles. La question du médium de transmission des recherches est un enjeu important, sachant que le savoir artistique ne se transmet pas toujours bien par l’écrit : pour présenter une recherche sur le jeu de l’acteur ou de l’actrice, par exemple, un workshop sera beaucoup plus efficace qu’un livre ou une thèse écrite, même si ces derniers peuvent s’avérer utiles.
Apports de la recherche‑création
La création artistique constitue plutôt, dans ce cas, un apport expérimental et heuristique, en faisant émerger des idées et des pistes. Elle éclaire alors différemment des études de cas ou des terrains ; elle en trouble ou en opacifie les clartés théoriques pour relancer des questionnements ; elle permet de travailler sur les obstacles épistémologiques inhérents à toute science (Bachelard, 2004).
Si elle donne à penser autrement, c’est fondamentalement parce qu’elle renoue avec l’entièreté de nos identités de chercheurs et chercheuses. Comme l’écrit Michel Bitbol (2016), « les chercheurs scientifiques rêvent de contourner leurs corps, ou de les rendre pour ainsi dire transparents », alors que le corps participe pourtant de nos gestes et procédures de recherches, y compris les plus abstraits.
La recherche‑création conteste la fiction, propre à la science moderne, du « cerveau-dans-un-bocal » (Latour, 2007), qui forge un langage capable de dire le monde sans reconnaître toute la chaîne, hétérogène et inventive, du travail qui permet aux chercheurs et chercheuses de passer du monde aux mots, et qui les lie étroitement à ce monde.
 Avec la recherche-création, une chance nous est donnée de repenser la recherche sur un mode plus réaliste, en n’escamotant plus nos relations et notre appartenance au monde, et en reconnaissant les moteurs existentiels, affectifs, engagés, corporels, intimes et politiques, de nos travaux – moteurs sans lesquels nous serions, tout simplement, incapables de les produire et de leur donner un sens.
Avec la recherche-création, une chance nous est donnée de repenser la recherche sur un mode plus réaliste, en n’escamotant plus nos relations et notre appartenance au monde, et en reconnaissant les moteurs existentiels, affectifs, engagés, corporels, intimes et politiques, de nos travaux – moteurs sans lesquels nous serions, tout simplement, incapables de les produire et de leur donner un sens.
► Références• Bachelard Gaston, La formation de l’esprit scientifique [1938], Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2004• Bitbol Michel, « À propos du point aveugle de la science », in Gérald Hess et Dominique Bourg (dir.), Science, conscience et environnement : penser le monde complexe, Paris, Presses universitaires de France, 2016 • Latour Bruno, L’Espoir de Pandore [1999], Paris, La Découverte, 2007 |