Publié le 15 mai 2025
–
Mis à jour le 28 janvier 2026
le 7 mai 2025
de Pierre Cornu, Stéphane Frioux, Anaël Marrec, Charles-François Mathis et Antonin Plarier
Une histoire environnementale de la France 1870-1940 (vol. 2*)
Moment pivot dans l'histoire environnementale de la France, la IIIe République est profondément marquée, jusque dans son idéologie, par une certaine conception de la nature et de l'environnement. Elle se distingue par une identité duale, tout à la fois celle de la petite paysannerie et des paysages ruraux, et celle des hauts lieux de la modernité dont Paris est l'archétype.La période prise entre les bouleversements du premier XIXe siècle et la "Grande Accélération "d'après 1945, se caractérise par un fort volontarisme politique qui cherche à accompagner le " progrès " – notamment celui porté par la deuxième industrialisation – dans les transformations qu'il fait subir au territoire.
Si les moyens ne sont pas toujours à la hauteur, l'ambition est là : jardiner le plus intensément possible la France, la rendre productive dans tous ses recoins pour favoriser la prospérité de la nation. Cette mise à profit des ressources naturelles s'appuie également sur un empire colonial qui s'étend et se structure, et dont l'environnement est bouleversé par le prométhéisme républicain et sa logique d'extraction.
Pour ce régime né et mort de défaites militaires, et qui a dû affronter les horreurs du premier conflit mondial, la guerre est l'horizon constant : elle détermine à son tour un rapport singulier à une nature à mobiliser ou à soigner. La IIIe République est ainsi ce moment historique singulier, tissé d'audace et de prudence dans le rapport des contemporains à la modernité et à l'environnement, où s'esquisse le visage de la France d'aujourd'hui.
* Le premier volume, La nature en révolution, était consacrée à la période 1780-1870.
Les auteurs et autrices
| ♦ Pierre Cornu est professeur des universités en Histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 (UFR Temps et territoires) et chercheur au laboratoire d’études rurales (LER), en détachement à l'INRAE. Parmi ses intérêts de recherche figurent notamment l'épistémologie historique des sciences du vivant et histoire critique des relations sciences-sociétés, l'histoire des théories critiques de la modernité dans son rapport à la nature et l'approche interdisciplinaire de l’environnement. ♦ Stéphane Frioux est maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 (UFR Temps et territoires), directeur du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) et co-porteur du projet Sainté@Lyon, qui met en perspective temporelle des problématiques actuelles de risques socio-sanitaires et socio-environnementaux. Il travaille à la croisée de l’histoire environnementale, de l’histoire urbaine et de l’histoire de la santé. ♦ Anaël Marrec est chercheuse en histoire contemporaine au Centre François-Viète (Nantes Université), elle s'intéresse plus particulièrement à l'histoire des énergies renouvelables à l'époque contemporaine. ♦ Charles-François Mathis est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d’histoire environnementale et britannique. ♦ Antonin Plarier est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui travaille entre autres sujets sur l'histoire environnementale et l'histoire sociale. |
Informations pratiques
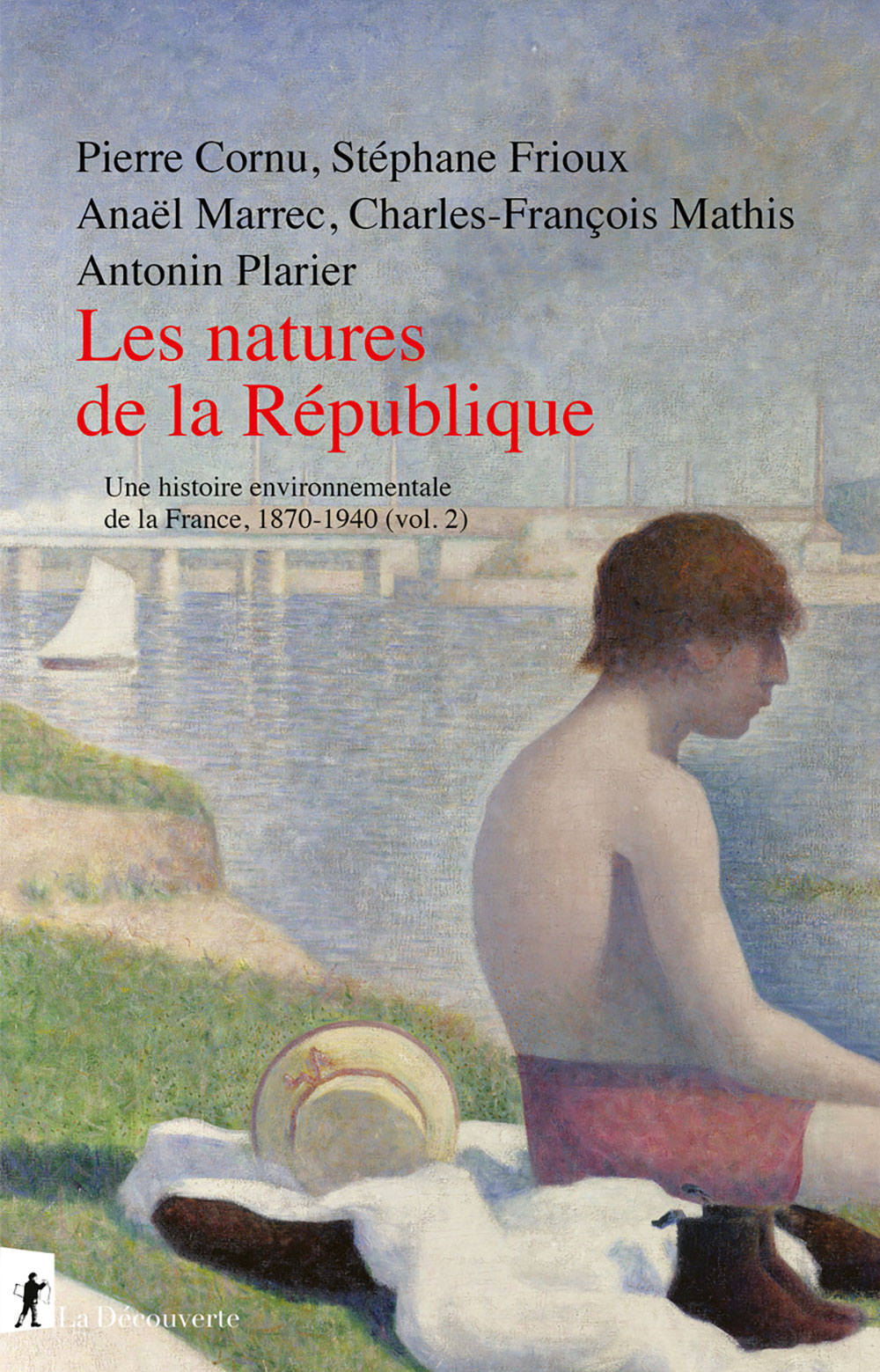
Références
Les natures de la République
de Pierre Cornu, Stéphane Frioux, Anaël Marrec, Charles-François Mathis, Antonin Plarier
éditions de la Découverte
Mai 2025 - 352 pages
ISBN : 9782348084409




