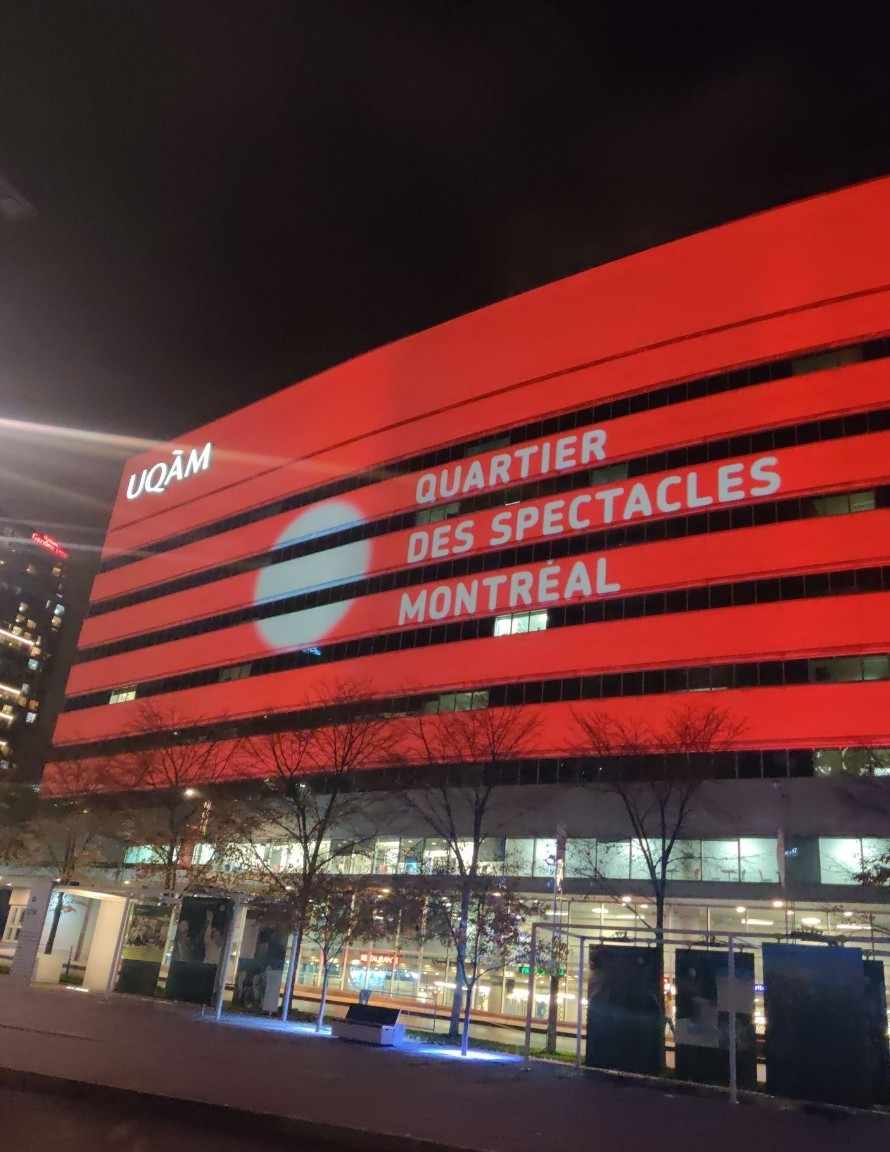Publié le 18 mars 2025
–
Mis à jour le 21 août 2025
le 18 mars 2025
Chaque année, la Fondation des Treilles remet un prix d'excellence à de jeunes chercheuses et chercheurs en fin de thèse afin de saluer l'originalité et la pertinence de leurs recherches. Parmi les lauréates et lauréats de l'édition 2025, Léa Buttard, doctorante en histoire, et Marceau Forêt, doctorant en histoire et études littéraires.
Cette année, la Fondation des Treilles a reçu 124 candidatures, de toutes les disciplines académiques. Après examen par le conseil scientifique de la Fondation, 33 jeunes chercheuses et chercheurs recevront un prix lors de la cérémonie organisée le 28 avril 2025 à l'ENS à Paris. L'annonce de cette distinction est l'occasion de mettre en lumière notre jeune recherche et de revenir sur les parcours de Léa Buttard et Marceau Forêt, qui ont quelques points communs tels que d'effectuer leur thèse en co-tutelle et d'avoir bénéficié d’une aide à la mobilité MobiDoc.
 Léa Buttard photographiant la dalle D183.
Léa Buttard photographiant la dalle D183.
Pour Marceau Forêt, l'attribution du prix « Jeune chercheur » de la Fondation des Treilles représente une forme de reconnaissance très encourageante pour les travaux qu'il a effectués jusqu’ici, d'autant plus que la Fondation des Treilles valorise les recherches interdisciplinaires qui font dialoguer sciences et arts. Ces principes sont au cœur de sa thèse (dans la continuité du premier financement qu'il avait obtenu, basé sur ces valeurs). Le prix étant associé à une bourse, celle-ci lui permet d’entamer la phase de rédaction de sa thèse dans les meilleures conditions possibles.

Marceau Forêt
(© Crédit : Robin Teillet)
Léa Buttard, doctorante en histoire
 Léa Buttard photographiant la dalle D183.
Léa Buttard photographiant la dalle D183.
| Léa : « Après un baccalauréat littéraire spécialité Arts-Plastiques, suivi de 2 ans de classe préparatoire à Grenoble, je me suis inscrite à l'Université Lumière Lyon 2 pour y effectuer une 3e année de licence d'archéologie. J'ai ensuite obtenu un master en Histoire et archéologie médiévales (HISTARMED), dans le cadre duquel j'ai pu réaliser un semestre à l'Université de Grenade. Je suis également titulaire du "Diplôme de l'EHESS", en ayant réalisé un mémoire sur les modes d'habitats du site d'al-Qusur, au Koweït. J'ai démarré en octobre 2021 une thèse, en co-tutelle avec l'Université Lumière Lyon 2 et l'Université de Grenade, sur les graffiti en al-Andalus à partir du site d'Albalat (en Espagne). » |
- Son doctorat et sa thèse
-
Titre : Pour une approche globale des pratiques graphiques en al-Andalus : graffiti et plateaux de jeux (Xe - XIIIe s.).
Direction : Cyrille Aillet, Alberto Garcias Porras et Sophie Gilotte (CNRS), en cotutelle avec l'Université de Grenade
Projet de thèse en Histoire | École doctorale : Sciences sociales (ED 483 : ScSo)
Laboratoire : CIHAM - Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans MédiévauxLéa : « Depuis 4 ans, je réalise une thèse sur les graffiti et plateaux de jeu incisés sur les dalles de schiste qui couvrent les maisons du site archéologique d'Albalat (Xe - XIIe siècle) à Romangordo en Estrémadure (Espagne). Ces incisions sont finement réalisées et les thèmes sont variés : plateaux de jeu, étoiles à six branches (motifs magiques et protecteurs) mais aussi de nombreux motifs géométriques sont visibles. Tous ces graffiti sont les témoins d'un riche univers graphique, partagés par les habitant.e.s du site. Ils sont incisés dans les patios, ces espaces ouverts dans les maisons, ce qui reflète bien la fonction sociale de ces lieux.
Mon travail consiste à documenter, inventorier et analyser ce corpus graphique. 1 100 graffiti ont dores et déjà été référencés. Ce corpus novateur permet d'approcher le quotidien des populations, leurs modes de pensées et d'interroger leur rapport au temps libre et au divertissement. J'ai eu la chance, durant ma thèse, d'avoir des liens étroits avec l'Espagne puisque j'ai effectué plusieurs séjours à Romangordo et ai obtenu deux bourses de courts séjours à la Casa de Velázquez, à Madrid.. » - Focus sur sa mobilité en Espagne lors de sa 4e année de doctorat
-
Léa : « À l'automne 2024, j'ai candidaté au dispositif MobiDoc, qui permet de financer des mobilités à l'étranger d'une durée à l'étranger entre 1 et 6 mois. Je souhaitais effectuer une mobilité en janvier et février 2025 en Espagne et suis donc rentrée depuis peu. Une première étape s'est déroulée à Romangordo (Espagne) sur mon terrain de recherche, en lien direct avec ma thèse, où nous effectuons des campagnes de fouilles annuelles sous la direction de Sophie Gilotte. Début 2025, au début de ma rédaction de thèse, j'ai eu besoin d'effectuer des dernières vérifications sur mon terrain de recherche et dans les réserves du village où sont conservés certains graffiti. Il était nécessaire que j'affine certains dessins et photographies. Ce séjour m'offrait également la possibilité de travailler conjointement avec ma directrice de recherche sur des interprétations spatiales globales à l'échelle du site. » - Sa recherche sur le terrain en quelques photos
-
Léa Buttard photographiant une des dalles d'Albalat (Crédit : S. Gilotte)
Réalisation du calque de la dalle D057Quelques exemples de graffiti © Crédits : Léa Buttard
- Ses réponses au questionnaire de Proust
-
♦ Quelle est la ville où vous aimeriez vivre ?
Grenade.
♦ Quel est votre film culte ?
120 battements par minute de Robin Campillo.
♦ Si vous n'étiez pas devenue doctorante en histoire de l'art à Lumière Lyon 2, qu'auriez-vous aimé faire ?
J'ai longtemps hésité à faire des études d'Arts-Plastiques, en dessin, en techniques de l'imprimerie... Je suis très intéressée par les travaux et les expériences en lien avec les matérialités plastiques (travail sur la couleur, les textures, les motifs).
♦ Quel est votre mot favori ?
Chatouilles.
♦ Qu'est-ce qui vous fait peur ?
Le vide.
♦ Quel est le don que vous aimeriez posséder ?
Le don d'ubiquité.
♦ Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
El abismo del olvido, de Paco Roca.
♦ Que vous reproche-t-on souvent ?
D'être susceptible et têtue.
♦ Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Les bandes dessinées de Pico Bogue et La vie est une corvée de Salomé Lahoche.
♦ Que détestez-vous ?
L'injustice et l'inégalité.
♦ Quel est le moment de la journée que vous préférez ?
Le coucher du soleil.
Marceau Forêt, doctorant en histoire et en études littéraires

Marceau Forêt
(© Crédit : Robin Teillet)
| Marceau : « J’ai effectué une bonne partie de ma scolarité à l’Université Lumière Lyon 2. J’ai commencé par une licence bidisciplinaire Histoire-Science politique. C’est grâce à un cours de Pierre Cornu intitulé « Histoire sociale et culturelle de l’Europe » que j’ai découvert la pluralité des possibilités qu’offre la discipline historique et la multiplicité des façons de la pratiquer. J’ai donc continué en Master d’Histoire parcours Construction des sociétés contemporaines et travaillé pendant deux ans sur la perception des sciences et des techniques par les auteurs et autrices de science-fiction francophone des années 1970 en bande dessinée et en littérature. Mémoire que j’ai réalisé sous la direction de Pierre Cornu. Ce dernier m’a vivement encouragé à pratiquer une méthode interdisciplinaire ce qui m’a conduit à réaliser un Master en Littératures, arts et sciences sociales à l’Université de Poitiers. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante avec des enseignements de grande qualité et des rencontres intellectuelles décisives parmi lesquelles Raphaëlle Guidée et Denis Mellier. » |
- Son doctorat et sa thèse
-
Titre : Des étoiles à la Terre. Pour une histoire des usages de la science-fiction par les sciences sociales dans l'espace francophone des "années 1968" à nos jours.
Direction : Pierre Cornu, Jean-François Chassay, en cotutelle avec Université du Québec à Montréal
Projet de thèse en Histoire et études littéraires | École doctorale : Sciences sociales (ED 483 : ScSo)
Équipe de recherche : Laboratoire d'Études Rurales - Sociétés et espaces ruraux de l'Europe contemporaine (19e-21e siècles)Marceau : « Fort de mon parcours interdisciplinaire, j’ai obtenu un contrat doctoral à l’École urbaine de Lyon, un institut convergence fondé en 2017, qui finançait chaque année des thèses interdisciplinaires sur les enjeux de l’Anthropocène. Si l’institut est aujourd'hui fermé (l’équipe a depuis fondé Cité Anthropocène), nous avons été plus d’une vingtaine de doctorantes et doctorants toutes disciplines confondues à avoir obtenu un contrat doctoral. L’École urbaine de Lyon a offert un cadre stimulant pour débuter la thèse et a financé des projets originaux et novateurs.
C’est dans ce contexte que j’ai pu commencer un doctorat en cotutelle, en histoire à l’Université Lumière Lyon 2 et en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal sous la direction de Pierre Cornu et Jean-François Chassay. À travers ma thèse, je m’intéresse aux différentes façons avec lesquelles les chercheurs et chercheuses en sciences sociales mobilisent la science-fiction pour penser l’Anthropocène des années 1960 à nos jours dans l’espace francophone. Alors que le monde moderne occidental sépare distinctement sciences et fiction depuis le XIXe siècle, la fin des années 1960 a vu naître en France une nouvelle forme de dialogue entre ces deux pôles. Par son exploration des imaginaires, sa spéculation temporelle et ses thématiques, la SF devient ainsi l’un des outils privilégiés pour appréhender la pluralité des changements écologiques. Il s’agit ainsi de faire le récit de dialogues, d’interférences et d’autres échanges entre deux champs qui ne se côtoyaient pas : d’un côté, les sciences sociales caractérisées par la rigueur, l’expertise et les méthodes scientifiques et de l’autre, la science-fiction associée à l’imaginaire, à l’esthétique et à la spéculation. » - Focus sur ses séjours au Québec pendant son doctorat
-
Marceau : « Dans le cadre de ma cotutelle et grâce aux bourses de l’École urbaine de Lyon et au programme Mobidoc de l'Université Lumière Lyon 2, j’ai pu effectuer plusieurs séjours au Québec. Ils ont été bien au-delà de mes attentes, marqués par la découverte d’une tout autre culture et d’une perception différente du parcours doctoral. Au Québec, les doctorantes et doctorants doivent suivre des cours chaque semaine et effectuer un examen de mi-parcours de doctorat. Ce système permet d’entretenir une certaine proximité avec le corps professoral et étudiant et d’avoir de nombreux retours réguliers sur sa thèse. De plus, mon directeur de thèse québécois, Jean-François Chassay, m’a bien intégré et m’a donné l’occasion de rencontrer plusieurs personnes parmi lesquelles Ketzali Yulmuk-Bray, doctorante en études littéraires, avec qui j’ai co-écrit un article l’an dernier.
Ces séjours au Québec m’ont aussi offert la possibilité de participer à diverses manifestations scientifiques passionnantes (colloques, séminaires, journées d’étude) et de consulter les archives à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec. En résumé, je suis très reconnaissant de pouvoir réaliser cette thèse en cotutelle, les aspects interdisciplinaire et international de mon doctorat l’enrichissent vraiment. » - Son expérience de recherche à Montréal en quelques photos
-
Consultation d'archives de la revue Solaris, revue de science-fiction québécoise, à la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)
Expérience de terrain sur un lac gelé dans le cadre du séminaire "Pratiques sémiotiques de l'espace" organisé par Rachel Bouvet© Crédits : Marceau Forêt
Campus des sciences de l'Université du Québec à Montréal
Campus de l'UQAM, pavillon Judith Jasmin construit autour du mur de la nef de l'église Saint-Jacques de Montréal - Ses réponses au questionnaire de Proust
-
♦ Quelle est la ville où vous aimeriez vivre ?
Je n’ai pas de ville où j’aimerais vivre par-dessus tout. J’ai adoré grandir à Villars-les-Dombes où je retourne souvent, j’ai passé plus de dix ans à Lyon à laquelle je me sens appartenir, j’aime beaucoup l’hybridité de Montréal. J’apprécie aussi aller régulièrement à Paris. Imaginons une utopie qui serait un mélange de tout cela.
♦ Quel est votre film culte ?
Mulholland Drive de David Lynch.
♦ Si vous n'étiez pas devenu doctorant en histoire à Lumière Lyon 2, qu'auriez-vous aimé faire ?
J’aurais sans doute essayé d’autres disciplines en sciences sociales. Dans une autre vie, j’aurais aussi aimé m’initier à la recherche en sciences de la matérialité et du vivant.
♦ Quel est votre mot favori ?
Je parlais d’hybridité pour qualifier Montréal, c’est un de mes mots favoris qui caractérise souvent ce que j’aime et ce qui m’intéresse.
♦ Qu'est-ce qui vous fait peur ?
Difficile de répondre autre chose que la situation écologique, la montée de l’extrême droite et la radicalisation des partis néo-libéraux. Plus intimement, j’ai peur du temps qui passe autant que je l’apprécie. Cocasse pour un historien qui travaille sur la problématisation de l’avenir.
♦ Quel est le don que vous aimeriez posséder ?
Quand je pense à des dons « surhumains », je ne peux pas m’empêcher de les voir comme des fardeaux, alors je n’arrive pas vraiment à répondre à cette question. Ça constitue peut-être une réponse en soi ?
♦ Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?
En fiction, L’invention de la mer, de Laure Limongi, et en sciences sociales, La ville d’après, de Raphaëlle Guidée. Je les recommande vivement tous les deux.
♦ Que vous reproche-t-on souvent ?
Si dans le cadre professionnel j’attache une importance particulière à la ponctualité, mes amis me reprochent parfois mon retard.
♦ Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Beaucoup de choses, mes proches avant tout. J’aime aussi beaucoup rire de l’absurdité de personnages, fictifs ou réels, naïvement et fièrement convaincus d’être dans le vrai sans avoir conscience d’être à côté de la plaque, un peu à la Michael Scott dans The Office.
♦ Que détestez-vous ?
Je déteste l’injustice, l’individualisme, le manque de réflexivité et d’empathie.
♦ Quelle est votre devise ?
Curiosité, écoute, analyse, empathie et nuance. Je ne sais pas si c’est une devise, mais ce sont des valeurs que j’applique autant dans la recherche que dans mon rapport aux autres.
♦ Quel est le moment de la journée que vous préférez ?
J’adore la nuit pour son côté calme, mais aussi enivrant. J’aime également beaucoup le matin quand la ville se réveille.
♦ Avez-vous un modèle (scientifique, essayiste, personnalité…) ou une personne qui vous inspire ?
Je n’ai pas de modèle, mais je peux citer trois philosophes, eux aussi hybrides, et décisifs dans mon parcours intellectuel. Theodor Adorno, Walter Benjamin et Isabelle Stengers qui ont chacun à leur manière interrogé les rapports entre art et rationalité.
Informations pratiques
Partenaires
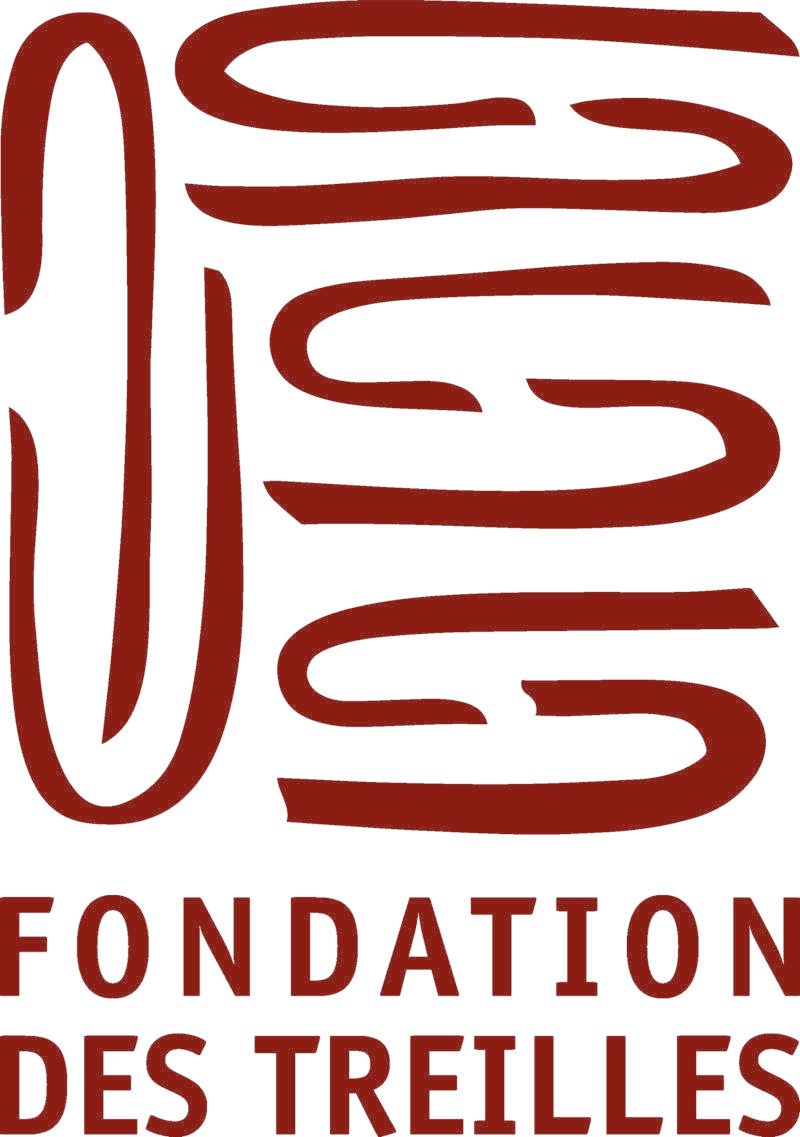 La Fondation des Treilles a été créée par Anne Gruner-Schlumberger (1905-1993). Elle est un lieu qui favorise le dialogue entre créateurs et chercheurs. La Fondation des Treilles a été créée par Anne Gruner-Schlumberger (1905-1993). Elle est un lieu qui favorise le dialogue entre créateurs et chercheurs.Depuis 1981, la Fondation des Treilles accueille ainsi chaque année des équipes internationales de recherche dans tous les domaines de la science, des lettres et des arts dans le cadre de séminaires, d’ateliers et de résidences de recherche. Afin de soutenir la recherche en devenir, elle attribue chaque année un prix à des jeunes chercheurs et chercheuses, ouvert à toutes les disciplines, à des doctorantes et doctorants français ou de nationalité étrangère en fin de thèse menant leur recherche en France. D’un montant de 6 000 euros, il est décerné par le conseil scientifique de la Fondation des Treilles. |