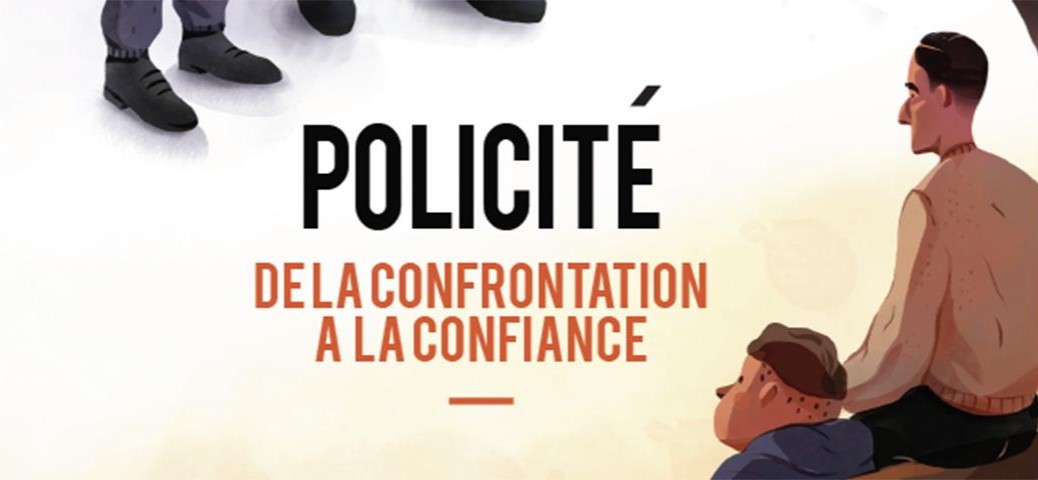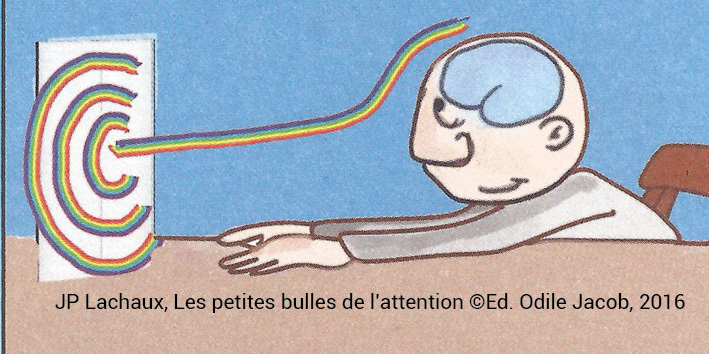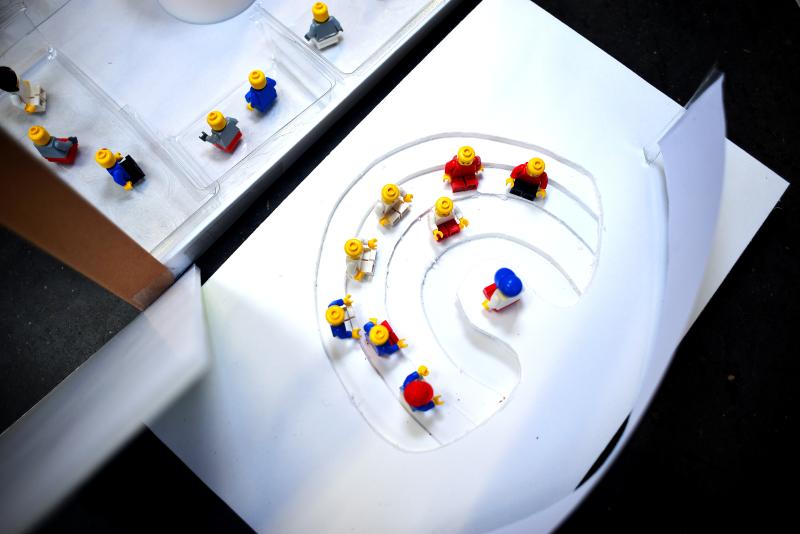Séminaires « Faire société, faire science ensemble ? » organisés par la Boutique des Sciences dans le cadre du projet LYSiERES²
- L’évaluation d’impact des associations : quand l’université s’en mêle
-
Replay du 12 février 2025
En partenariat avec la Chaire ESS (GT Impact social)
Les associations, et plus largement les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), mettent en œuvre une pluralité d’évaluation de leurs actions et de leurs effets, que ce soit dans le cadre de démarche d’amélioration continue, pour communiquer auprès de leurs partenaires, à la demande des financeurs, etc. Si pendant plusieurs décennies, les associations ont mis en avant l’évaluation de leur utilité sociale, on observe depuis quelques années la diffusion d’un nouveau référentiel évaluatif autour la mesure d’impact social.Mais comment mettre en œuvre concrètement ces évaluations et notamment une mesure d’impact social dans les associations ?
N’ayant souvent pas les moyens et les compétences en interne pour se lancer dans une démarche évaluative, les associations se tournent souvent vers des formations de l’enseignement supérieur pour se faire accompagner et confier cette mission aux étudiants et étudiantes dans le cadre d’un stage, d’une alternance ou de projets pédagogiques. Les associations peuvent aussi s’adresser plus directement à des chercheurs et chercheuses pour se faire accompagner dans leur démarche d’évaluation.
Parfois considérée comme une prestation à moindre coût, comme une caution scientifique ou s’inscrivant dans une réelle démarche pédagogique, les étudiants comme les enseignants, les chercheurs et les encadrants se trouvent souvent démunis face aux enjeux de l’évaluation. Ces situations faisant naître des tensions et malentendus.
Ce constat est dressé par une pluralité d'acteurs et actrices de l’Université Lumière Lyon 2 (la Boutique des Sciences, les Masters ESS ou encore la Chaire ESS) qui sont régulièrement sollicités pour répondre aux besoins d’évaluation des associations. Ces demandes posent un certain nombre de questions : Les étudiantes et étudiants sont-ils formés à ce type de démarche ? (De quelles compétences évaluatives disposent-ils ? Peuvent-ils développer ?) Les situations de formation (stage, alternance) sont-elles pertinentes pour répondre aux demandes de mise en place d’évaluation des structures ? Les encadrantes et encadrants – professionnel et formation – sont-ils en mesure d’accompagner ce type de mission ? Quelles articulations entre les attendus professionnels, pédagogiques voire scientifiques ? Quelles attentes réciproques entre les étudiants/étudiantes et leurs encadrants/encadrantes ?
L’objectif de cet atelier est justement d’ouvrir le dialogue et de tenter de clarifier les interrogations autour de l'évaluation d'impact en apportant des pistes de meilleure compréhension. - One Health et Recherche participative : comment construire la santé globale avec la société ?
-
Replay du 4 décembre 2024
En collaboration avec SHAPE-Med@Lyon
Quels liens peut-on construire entre les santés humaines, animales et l’environnement ? C’est ce que le concept One Health (Santé globale) essaie de comprendre. Dans le foisonnement de ces réflexions, la Boutique des Sciences de l’Université Lumière Lyon 2 a proposé un temps de réflexion sur ce sujet en adoptant son prisme particulier : celui de la recherche participative.
Comment peuvent converger les recherches participatives et le concept One Health ? Quelles places pour les citoyennes et les citoyens dans ces recherches ? Pour répondre à ces questions, cette matinée donnera la parole à des chercheuses et chercheurs ainsi qu’à des personnes impliquées dans des recherches à travers un temps d'échanges autour de la place des recherches participatives en santé et la présentation de trois projets utilisant le concept One Health.Première partie :
Introduction sur les recherches participatives par Marie Préau, professeure en psychologie sociale (PÔPS, Bureau SHAPE-Med@Lyon)
Tour d'horizon de la recherche participative en santé par Léandre Guignier, chargé de projet santé pour la Boutique des Sciences
Présentation du projet Draconis sur les troubles neurocognitifs et psychologiques des traitements contre le cancer, avec :- Maïssa Fadhlaoui, ingénieure d’études en psychologie sociale
- Véronique Lefebvre, patiente concernée, association ALK et ROS1 France Cancer Poumon
- Pierre Nicot, psychiatre (CRNL, Le Vinatier)
Deuxième partie :
Présentation du projet Astéropa sur les PFAS dans le sud lyonnais, avec :- Julien Biaudet, sociologue au Centre Léon Bérard et responsable prévention primaire & promotion de la Santé
- Patricia Grange-Piras, citoyenne impliquée
- Chloé Moulin, chargée de mission au CLB
Présentation du projet Citique sur l'écologie des tiques et les maladies zoonotiques qu'elles véhiculent, avec :- Pascale Frey-Klett, directrice de recherche à INRAE (ARBRE) et responsable « Tous chercheurs »
- Philippe Lecomte, ingénieur d’étude (INRAE) et directeur adjoint de l’UMR EpiA
- Libertés associatives et libertés académiques : mêmes enjeux ?
-
Replay du 18 septembre 2024
Avec Mickaël Huet, délégué général du Mouvement Associatif ;
Justine Cazaux de l'Action Justice Climat Lyon (ex Alternatiba ANR Rhône) ;
Jean-Baptiste Jobard du Collectif des Associations citoyennes et auteur de « L'histoire des libertés associatives »
Claude Gautier et Michelle Zancarini Fournel, chercheur·es et auteur/trices de « De la défense des savoirs critiques, quand le pouvoir s’en prend à l’autonomie de la recherche ».
Animé par Benoit Chaboud Mollard du Le Mouvement Associatif Auvergne Rhône-AlpesLa table ronde était précédée d'un après-midi ateliers et contextualisation ouvert aux associatifs, étudiant·es, doctorant·es et enseignant·es-chercheur·es, dont le compte-rendu est disponible ici.Depuis la mise en place du Contrat d’Engagement Républicain de nombreuses associations et têtes de réseau associatives alertent sur une dégradation alarmante des libertés associatives, illustrée notamment par la perte de subsides pour des collectifs écologistes ainsi jugés ‘non républicains’. Dans le même temps, des voix s’élèvent dans le milieu académique pour alerter sur les libertés académiques, qui garantissent l’autonomie intellectuelle de la recherche et de l’enseignement universitaires. Quels sont les marqueurs réels de ces dynamiques ? Qu’ont-elles de commun entre elles et de fondamentalement différent ? - Un tiers-veilleur : pourquoi, comment ?
Quel accompagnement des projets de recherche participative ? -
Replay du 15 février 2024
Avec Tristan Lescure (ANR), Julia Bonaccorsi (VP Sciences et Société Lyon 2), Evelyne Lhoste (INRAE)
Animé par Isabelle Proux (École de la Médiation)
En collaboration avec l’École de la Médiation et Sciences CitoyennesQuels liens peut-on construire entre les santés humaines, animales et l’environnement ? C’est ce que le concept One Health (Santé globale) essaie de comprendre. Dans le foisonnement de ces réflexions, la Boutique des Sciences de l’Université Lumière Lyon 2 a proposé un temps de réflexion sur ce sujet en adoptant son prisme particulier : celui de la recherche participative.
Comment peuvent converger les recherches participatives et le concept One Health ? Quelles places pour les citoyennes et les citoyens dans ces recherches ? Pour répondre à ces questions, cette matinée donnera la parole à des chercheuses et chercheurs ainsi qu’à des personnes impliquées dans des recherches à travers un temps d'échanges autour de la place des recherches participatives en santé et la présentation de trois projets utilisant le concept One Health.
Podcasts séminaires de la Boutique des Sciences autour de la recherche participative
- PoliCité : une recherche sociologique participative sur les rapports police/population à Vaulx-en-Velin
-
Replay du 23 juin 2021
Avec Anaïk Purenne, sociologue à l’École de l’aménagement durable des territoires (ENTPE)
Samia Bencherifa, coordinatrice du pôle Ados du centre social Georges-Lévy
et Adballah Slimani, membre du collectif Policité
Le collectif PoliCité mène depuis cinq ans une « recherche-action participative » sur les rapports entre les forces de l’ordre et la population, en particulier les jeunes, et sur les représentations qui en découlent. Il est composé de sociologues, d'une travailleuse sociale et d’habitant.e.s jeunes de Vaulx-en-Velin qui ont travaillé ensemble pour cerner et décortiquer ces rapports et comprendre les mécanismes sociologiques à l’œuvre.
De ce travail est notamment ressortie une BD, mais aussi des articles, des conférences de consensus, des interventions en milieu scolaire ou encore au sein du réseau des écoles de service public ou à l'UNESCO, mais surtout chaque acteur en est ressorti changé, dans son rapport aux autres et à la construction du savoir.
La Boutique des sciences vous invite à consulter en amont de ce podcast, les ressources suivantes : - Retours d'expériences de Boutiques des Sciences africaines
-
Replay du 10 juin 2021
Avec Diéyi DIOUF, Responsable Boutique des Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Assane FALL de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Binta BARRY de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Hichem BEN HASSINE, Coordinateur de "Science Ensemble-العلم مع بعضنا", la Boutique des Sciences de l'Institut Pasteur de Tunis
et Hayet MOUSSA, Socio-anthropologue à l'Institut Supérieur de Sciences Humaines de Tunis
Les Boutiques des Sciences de Tunis et Dakar pratiquent la recherche participative en s'adaptant aux contextes et questions soulevées par la société civile
L'Institut Pasteur de Tunis (IPT) est un établissement public de Santé et de Recherche affilié à l'Université Tunis El Manar. Il a mis en place une Boutique de Sciences (BdS) en 2017 dans le cadre du projet européen InSPIRES. Les domaines d'interventions de cette BdS concernent la santé, l'environnement et les populations vulnérables. Les projets de la BdS de l'IPT sont mis en place en appliquant les principes de la Recherche et de l'Innovation Responsable et de la Science Ouverte (Open Science) et tentent de développer une approche transdisciplinaire pour se rapprocher d'une solution globale qui réponde aux besoins des associations et à l'intérêt général. Jusqu'à présent la BdS de l'IPT a implémenté 10 projets BdS, dont 2 projets Transnationaux, dans différents domaines et régions de la Tunisie, qui seront présentés lors de ce séminaire en ligne.
Au Sénégal, la loi n° 2015-02 du 06 janvier 2015 confère aux universités publiques, en plus des missions d’enseignement et de recherche, une 3ème dénommée « Service à la communauté » (SAC). Le SAC est valorisé comme une partie intégrante des obligations des personnels (PER et PATS) des universités sénégalaises. Le Sénégal est aussi empreint d’ une forte présence d’associations, de mouvements actifs et surtout très réactifs aux besoins des populations locales. C’est dans ce contexte que la première BdS d’Afrique de l’ouest francophone « Savoirs de tous au profit de tous » a été créée en mai 2015 pour accompagner les acteurs en quête permanente de solutions à des défis sociétaux dans la co-construction de projets de recherche-action, prenant en compte les objectifs de développement durable. La BdS pluridisciplinaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a contribué et accompagné l’IRD et l’AUF dans les projets PARFAO au profit de pêcheurs artisanaux, d’agro-écologistes et d’associations de femmes transformatrices de produits halieutiques, ce qui a permis de faire collaborer au sein d’un même panel, des scientifiques et des communautés non alphabétisées à travers une approche innovante. - Culture Inclusive : une recherche participative en milieux culturels montréalais
-
Replay du 1er avril 2021
Avec William-Jacomo Beauchemin, Chercheur et médiateur à Exeko
Cette intervention présente un compte-rendu du projet Culture Inclusive, une recherche action participative menée à Montréal depuis 2016 avec une vingtaine de partenaires, dont 10 institutions culturelles et 8 associations communautaires. Le projet visait à recenser et à documenter les freins en termes d'accessibilité, d'inclusion et d'équité, en impliquant comme co-chercheur·es des personnes vivant directement ces freins. À travers différentes méthodologies créatives et adaptées de recherche, le projet a permis une analyse collaborative des défis présents au sein des milieux culturels, et de co-rédiger une charte servant d'outils directeurs, de boussole éthique et de politique interne pour les institutions partenaires. Au cours de la présentation, nous nous penchons principalement sur le processus et les méthodologies de recherche, afin de partager les techniques de recherche participative qui ont particulièrement bien fonctionné et de mettre en lumière les défis partenariaux qui se sont présentés au cours du projet.
- Instruments voyageurs : une recherche appliquée sur les patrimoines musicaux des habitants de Villeurbanne
-
Replay du 4 mars 2021
Avec Laura Jouve-Villard, Chargée de recherche au CMTRA
et Vincent Veschambre, Géographe et directeur du Rize
Construit par Le Rize, le CMTRA (Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes) et l’ENM (École Nationale de Musique, danse et art dramatique), Instruments Voyageurs est aujourd'hui un parcours d’exposition, une programmation de concerts, ateliers et rencontres qui sont le fruit de ce travail collectif d’enquêtes et de recherches documentaires. Dans notre quotidien, à la maison, dans la rue… les instruments de musique sont les témoins d’échanges, de circulations et d’interconnexions entre cultures et langages musicaux. Instruments voyageurs invite à la découverte d’instruments d’ici, d’ailleurs, voire de nulle part, révélateurs de multiples phénomènes d’emprunts et de transferts culturels. Vous pouvez retrouver ici un avant-goût de l’exposition Instruments voyageurs grâce à sa déclinaison numérique, où les « instruments » sont prêts à vous faire voyager. Deux stagiaires de la Boutique des Sciences avaient également pris part au projet en 2019.
Laura Jouve-Villard et Vincent Veschambre présenteront lors de ce séminaire comment cette démarche a émergé et a intégré les habitants et habitantes de Villeurbanne dans une volonté de croisement de savoirs. Quels bousculements de problématique et de vision la rencontre entre habitants, scientifiques et associatifs ont-ils produits ? Quelles difficultés le projet a-t-il pu connaître ? Quelles médiations et intermédiations ont-elles été mobilisées ? Quels résultats et impacts aujourd'hui sur ce territoire ?
Retrouvez l'exposition dans sa déclinaison numérique
Découvrez le travail de recherche de deux stagiaires de la Boutique des Sciences sur le sujet - Croiser les savoirs scientifiques avec ceux des jardiniers du quotidien
-
Replay du 4 février 2021
Avec Jeanne Cartier-Millon, jeune chercheuse et ancienne étudiante de la Boutique des Sciences
Béatrice Maurines, Sociologue au Centre Max Weber
et Florian Charvolin, Sociologue au Centre Max Weber
Comment croiser les savoirs scientifiques avec ceux des jardiniers du quotidien ? Depuis 2017, le PASSE-Jardins a créé un collectif de travail mixte, composé de salarié·es et de bénévoles, de chercheur·es et non chercheur·es dont l'objectif est de sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité dans les jardins partagés. Les outils des sciences participatives y questionnent le rapport des jardinier·ères à la biodiversité ordinaire présente dans leur quotidien et constituent un ressort privilégié à la sensibilisation et à la compréhension des écosystèmes. Mais comment pérenniser l'implication des jardinier·ères dans le temps ? Comment proposer un suivi complet du protocole (de l'observation à la saisie des données) ? Comment valoriser les données au niveau local ?
C'est à ces questions que le projet de Jeanne Cartier-Millon a tenté de répondre en 2020 dans le cadre de la Boutique des Sciences. Elle en présente ici les résultats et les limites. Béatrice Maurines retrace la genèse, les avancées et les difficultés de la collaboration de cette association de jardiniers avec le monde de la recherche, ré-interrogeant l'intérêt spécifique des méthodes participatives pour cet objet. Enfin, Florian Charvolin apporte un éclairage sur la définition et les impacts de ce type d'approche et leur place dans les paysages scientifiques et les territoires. - Les impacts d'une Boutique des Sciences : dispositif porte d'entrée vers la recherche participative ?
-
Replay du 7 janvier 2021
Avec Hélène Chauveau, chargée de projet pour la Boutique des Sciences et anciennement post-doctorante sur le travail d'étude d'impact
Dominique Gilles, du Conseil de Quartier Croix Rousse
Pierre-Chanel Hounwanou, doctorant et ancien étudiant de la Boutique des Sciences
et Rachel Linossier, enseignante-chercheuse et encadrante de plusieurs stages Boutique des Sciences
En 2019, après sept années d’existence, la Boutique des Sciences de l’Université de Lyon a choisi de travailler sur une étude de ses impacts. Cette étude est triple car cherche à saisir les effets de l’action de ce dispositif : à quel point permet-il de créer de « nouveaux savoirs » ou de nouvelles façons d’appréhender la connaissance ou une problématique donnée en croisant recherche universitaire et savoirs co-construits avec les acteurs et actrices ? La « simple » réponse à une demande sociale d’expertise a-t-elle la même teneur ? Qu’est-ce que la recherche participative crée de différent par rapport à un autre type de recherche ? Comment juger de la qualité de la relation entre les partenaires impliqués ? Quels problèmes de temporalités, vocabulaire et attentes entre les différents partenaires ? Quel rôle de la médiation dans ces processus ? Un des résultats de cette étude d’impact est que l’accompagnement par les chargé·es de projet est résolument la valeur ajoutée principale de la Boutique des Sciences. La mise en lien des acteurs selon leurs besoins et profils respectifs, la formation des étudiant·es (pendant les stages) et des structures (pour la formulation de leur demande) ainsi que la capacité à accompagner sur mesure chaque projet est le point fort de la Boutique des Sciences de Lyon. En revanche, le lien aux labos et masters pourraient être approfondis et la dimension « recherche » de ses travaux est discutée par certaines parties-prenantes.Design et recherche participative : les apports du design participatif à la problématique des risques (santé et climat)
- Design et recherche participative : les apports du design participatif à la problématique des risques (santé et climat)
-
Replay du 3 décembre 2020
Avec Marie-Julie Catoir-Brisson, Maîtresse de conférences en design et communication à l’Université de Nîmes et membre permanente du laboratoire PROJEKT (EA 7447) spécialisé dans l’innovation sociale par le design. Docteure en sciences de l’information et de la communication, elle est aussi membre associée au laboratoire MICA (Médiation, Information, Communication, Arts - EA 4426) de l’Université Bordeaux-Montaigne.
Les méthodes de co-design ou design participatif sont de plus en plus mobilisées dans des recherches interdisciplinaires impliquant des citoyens. Elles offrent de nouvelles opportunités de collaboration entre la recherche et la société, permettent de développer de nouveaux outils de co-production des connaissances et résultats en lien avec des acteurs et actrices dont les problématiques sont ancrées dans des territoires, mais rencontrent aussi des freins et des difficultés à s’implémenter, notamment dans certains champs d’intervention spécifiques.
L’objectif de cette communication est de présenter les apports et limites des méthodes de recherche et design participatifs à la problématique des risques (santé et climat). Ces deux champs d’intervention et les recherches participatives qui y sont associées - portant respectivement sur les problématiques de l’insomnie chronique d’une part et sur le risque canicule d’autre part - sont mobilisés pour aborder des questions transversales à la recherche participative : pourquoi faire participer ? Avec quels acteurs et actrices ? Quels savoirs et résultats sont co-produits avec les participant·es ? Quels apports et quelles limites à ces approches dans ces deux champs d’intervention ?
Cette intervention vise aussi à partager des réflexions épistémologiques sur les outils de médiation, les actions et la posture du·de la chercheur·e engagé·e dans une recherche participative avec les acteurs et actrices concernés : quel lien avec d’autres formes de recherche et de conception participatives ? En quoi la recherche-projet en design social renouvelle t-elle la recherche-action participative ? Quelles sont les compétences nécessaires aux chercheurs et participants ?
Il s’agit alors d’expliciter la manière dont la médiation scientifique, ancrée dans une dynamique d’innovation sociale et territoriale, est renouvelée par les méthodes de co-design. - Médiation scientifique et sciences participatives
-
Replay du 8 octobre 2020
Avec Marie-France Mifune, docteure en anthropologie et consultante en médiation scientifique
La médiation habituellement pratiquée dans les musées et centres de CSTI se trouve reconfigurée dans les projets de science participative. Ici sont évoqués deux programmes de sciences participatives (Vigie-Ciel et Lichens Go !) où deux principes fondamentaux viennent modifier ses pratiques et ses visées : la participation des publics, et l’intégration de la médiation à un programme de recherche. La reconfiguration de la médiation se situe au niveau des outils de médiation, des actions et des postures des médiateur·rices mais aussi au niveau de sa temporalité. Elle s’inscrit dans un temps long, car elle y suit les étapes du processus scientifique.
La stratégie de mettre en place un réseau de partenaires relais est essentielle dans ce type de programme car les structures locales connaissent leurs publics et leurs territoires. Selon leurs pratiques et usages, elles intègrent au sein de leurs activités des contenus spécifiques aux projets. Cette stratégie est bénéfique pour l’ensemble des partenaires : cela leur permet d’initier de nouvelles collaborations, de créer de nouveaux contenus de médiation, d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances, de gagner une certaine légitimité auprès des collectivités et de renforcer leur attractivité auprès des publics. En caractérisant la médiation scientifique dans ces programmes de sciences participatives et en proposant un référentiel de compétences des médiateur·rices, Marie-France Mifune souhaite ici apporter des réflexions et outils pour permettre de mieux concevoir et envisager la médiation scientifique dans les sciences participatives. - Éduquer à l’attention : quand les neurosciences font de la recherche participative
-
Replay du 6 mai 2020
Avec Bénédicte Terrier, Ingénieure de recherche Neurosciences, Pédagogie et Valorisation sociétale (Inserm)
et Stéphanie Leautier Massire, enseignante en primaire et directrice d'école à Oullins
ATOLE (ATtentif à l’écOLE) est un programme de découverte et d'éducation à l'attention en milieu scolaire qui s'inspire des dernières découvertes en neurosciences. À l'origine de ce projet de recherche collaboratif, réalisé à la demande, avec et pour les enseignant·es : l'envie de faire bénéficier, au plus grand nombre, les résultats des recherches en neurosciences cognitives sur l'attention (un des thèmes de recherche les plus étudiés au niveau international), et en particulier au bénéfice des jeunes générations, confrontées à la richesse du monde numérique ! L'objectif du programme ATOLE est d'aider l'élève à mieux comprendre son cerveau et les forces qui bousculent son attention au quotidien, puis à apprendre à mieux y réagir, non seulement en classe mais aussi en dehors. Comme un funambule apprenant à se tenir sur un fil, le programme ATOLE explicite une voie pour développer son sens de l'équilibre attentionnel, et pour maintenir son esprit stable de manière autonome. Concrètement, cette recherche participative met en lumière l'importance d'un transfert sociétal des recherches en neurosciences cognitives, tout en posant de nombreuses questions pratiques, scientifiques, éthiques, mais aussi diverses problématiques de financements de la recherche à visée sociétale, de changements d'échelles de diffusion et de conditions d'engagement des différents acteurs, en vue de tendre vers un changement radical de notre « hygiène attentionnelle », pour « petits et grands ».
- Quelles rencontres entre savoirs d’agronomes et savoirs d’agriculteur·rices ?
-
Replay du 10 mars 2020
À travers la présentation d'une diversité de recherche en partenariat, des chercheur·es sont ici invité·es à échanger sur les liens complexes entre agronomes, agronomie et prise en compte des professionnel·les, des citoyen·nes et de l’interdisciplinarité. Un temps coordonné par Hélène Brives, ingénieure de l’École Nationale des Ingénieurs des Travaux Agricoles de Dijon, docteure en sociologie de l’Université de Paris X-Nanterre et enseignante-chercheuse à l'ISARA. Elle travaille sur de nombreux projets autour des sols, de l’agroécologie ainsi que sur le rôle du conseil agricole, de l’innovation, et des connaissances dans le développement local et agricole.
- L'expérience Living Lab au service de la recherche en ingénierie et santé
-
Replay du 21 janvier 2020
Avec Vincent Augusto est docteure en génie industriel, membre permanent du corps professoral de l'École des Mines Saint-Étienne,Centre Ingénierie et Santé et co-directeur du living lab MedTechLab en partenariat avec EOVI Mcd.
Est discuté dans ce séminaire l’apport du processus de co-création à la recherche, avec plusieurs illustrations tirées des premières expérimentations du Living Lab : lit intelligent, maison de santé, activité physique des séniors. Un focus est apporté sur la transdisciplinarité afin de comprendre comment maximiser son efficacité.
- Défis d'une recherche participative sur la gouvernance des nanotechnologies
-
Replay du 9 décembre 2019
Avec Anne Dijkstra, professeure en communication scientifique à l'Université de Twente aux Pays-Bas
Cette présentation aborde les défis de la recherche participative dans le domaine des nanotechnologies.
- L’engagement aux communautés – Universités : l’expérience du service aux collectivités
-
Replay du 24 mai 2019
Avec Marcel Simoneau, directeur du Service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal. Actif depuis 40 ans, ce service développe une approche transversale et multi-disciplinaire et s'appuie sur un réseau de scientifiques, praticien·nes, groupes sociaux, syndicats etc.
Dans ce séminaire d’échanges de bonnes pratiques et de réflexion méthodologiques et épistémologiques sur le thème des recherches académiques co-produites avec des citoyen·nes (dites recherche participative), chercheur·es, étudiant·es et associations sont invité·es à poser leurs questions ou partager leurs expériences.
1er Forum de la Boutique des Sciences (2015)
- Partie 1 : Sciences et société ou comment interroger et métamorphoser nos formations et pratiques scientifiques
-
Introduction de Jean-Luc Mayaud, Vice-président sciences et société, Université de Lyon, Président de l’Université Lumière Lyon 2 - Partie 2 : La Boutique des Sciences de l’Université de Lyon, de sa genèse aux effets produits
-
Premier bilan par l’équipe de la Boutique des sciences : Robin Eppe et Davy Lorans - Partie 3 : Témoignages d'associations, d'étudiantes, étudiants, de chercheuses et chercheurs
-
Avec :
- Florent Missemer, de l’association Ocivélo
- René Marcand, du Conseil de Quartier Guillotière
- Louis Bonhême, ex-étudiant de l’Ecole Nationale des Services Vétérinaire
- Sarah Bellemare-Fayard, ancienne étudiante à l’Institut de Psychologie de l’Université Lumière Lyon 2
- Guy Le Henaff, chercheur à l’IRSTEA
- Florian Charvolin, enseignant chercheur au Centre Max Weber
- Partie 4 : Une idée commune pour une diversité de modèles
-
- L’École de l’innovation citoyenne, par Francine Verrier, directrice des relations avec la collectivité à l’École de Technologie Supérieure de Montréal
- Accès savoirs, la Boutique des Sciences de l’Université Laval, et ses satellites en construction en Afrique francophone, par Florence Prion, Université Laval et association Science et bien commun, Québec.
- Les Boutiques des Sciences : une idée commune pour une diversité de modèles en réponse aux besoins de la société, par Glen Millot, Fondation Sciences Citoyennes
- Partie 5 : La Boutique des Sciences dans le paysage des sciences impliquées
-
Intervention d'Alain Kaufmann, directeur Interface science-société, Université de Lausanne - Partie 6 : Vers un laboratoire d’innovation sociale ?
-
- La Boutique des sciences au cœur d’une excellence partagée: présentation de la candidature IDEX 2 par Pierre Cornu, membre du comité scientifique de la Boutique des sciences, Université Lumière Lyon 2
- Présentation des projets européens EnRRICH et NUCLEUS, programme science with and for society, HoriZon2020 par Florence BELAEN, Responsable du service Sciences et société
- Université de Lyon. Fabrique de l’innovation et Boutique des sciences : challenge scientifique France/Québec par l’équipe projet : Boutique des sciences, Fabrique de l’innovation, INSA, ENSAL et Université de Montréal