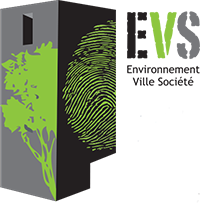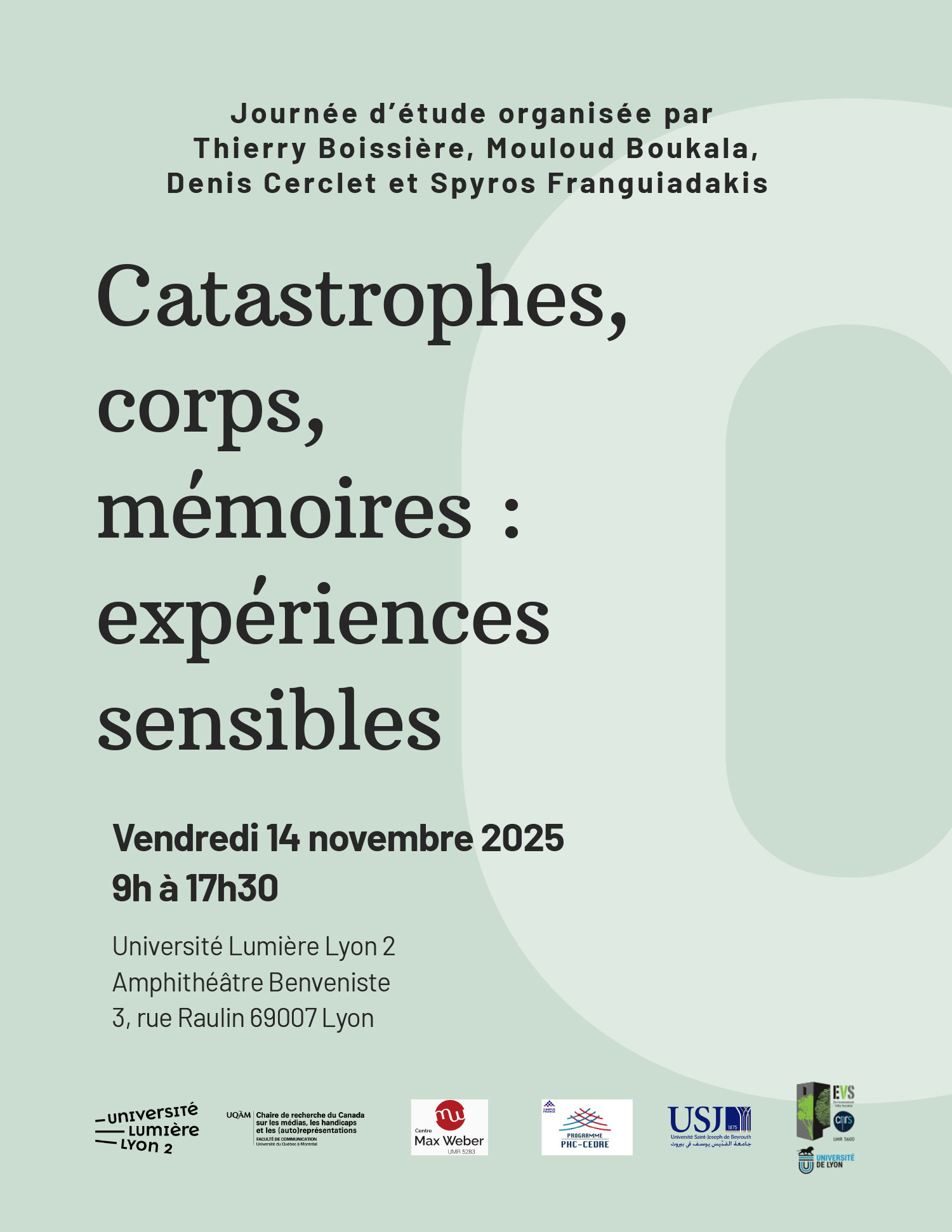Publié le 22 octobre 2025
–
Mis à jour le 6 novembre 2025
le 14 novembre 2025
Campus Berges du Rhône
de 9h à 17h30
Journée d’étude organisée par Thierry Boissière, Mouloud Boukala, Denis Cerclet et Spyros Franguiadakis, dans le cadre du programme de recherche "Approche sensible des catastrophes : Corps, Espaces, Mémoires et Explosions (ACEME)", soutenu par la procédure d’appel à projets pluridisciplinaire interne (APPI) de l’Université Lumière Lyon 2
Cette journée d’étude interrogera la manière dont les catastrophes – incendies, séismes, inondations, accidents industriels – marquent durablement les corps et les mémoires, au-delà de l’évènement traumatique. Elle explorera les processus d’incorporation, les réactivations sensorielles, ainsi que les narrations qui émergent de ces événements, en croisant anthropologie, sociologie, géographie et psychologie. Cette approche pluridisciplinaire examinera comment la catastrophe s’incarne dans les corps, les pensées et les espaces quotidiens, en analysant des phénomènes comme la sidération, la mémoire flash et les réactivations sensorielles. L’accent sera mis sur les transformations du rapport à l’espace urbain et sur la catastrophe comme expérience vécue, sensible et révélatrice des liens fragiles entre mémoire, corps et environnement.
Au programme
| 9h | Accueil des participantes et participants |
|---|---|
| 9h30-10h15 | ♦ Thierry Boissière (anthropologue, Université Lumière Lyon 2 / EVS) ♦ Annie Tohmé Tabet (anthropologue, Université Saint-Joseph, Beyrouth / CREEMO) « De AZF Toulouse au Port de Beyrouth : expériences sensibles et mémoires croisées des catastrophes : retour sur le programme de recherche ''Approche sensible des Catastrophes : Corps, Espaces, Mémoires et Explosions. Les cas du port de Beyrouth et de l’Usine AZF de Toulouse'' (ACEME) » Le programme ACEME mené depuis 2024 a permis d’explorer la manière dont une catastrophe « s’inscrit » durablement dans les corps, les gestes et les mémoires. À partir des cas des explosions de l’usine AZF à Toulouse (2001) et du port de Beyrouth (2020), nous avons interrogé les formes d’incorporation, de réactivation sensorielle et de mise en récit des expériences vécues. Fondée sur des enquêtes de terrain et des entretiens approfondis, le travail de recherche met en lumière la persistance du choc initial dans les perceptions quotidiennes, les rapports à l’espace urbain et les mémoires individuelles ou collectives. Thierry Boissière et Annie Tohmé Tabet proposeront un retour comparatif sur ces deux terrains afin d’analyser les modes de perception, de visibilité et de transmission propres à chaque contexte. |
Souvenirs flash et mémoires traumatiquesPrésidence de séance : Rita Zaarour (géographe, Université Saint-Joseph, Beyrouth / CREEMO) |
|
| 10h15-10h50 | ♦ Catherine Thomas-Anterion (neurologue et docteure en neuropsychologie HDR, chercheuse associée dans le laboratoire Études des Mécanismes cognitifs EA 3082-Lyon 2, membre -expert de l’Observatoire des mémoires B2V) « Les souvenirs flashs : le quoi, le quand, le où, le comment : ''normal et pathologique'' » L’intervention de Catherine Thomas-Anterion portera sur les souvenirs flashs (SF), souvenirs épisodiques marqués par une grande précision du contexte (où, quand, avec qui) et une forte charge émotionnelle, souvent liés à des événements publics inattendus et spectaculaires (11 septembre 2001, Coupe du monde 1998, etc.). Ces souvenirs sont au coeur de la mémoire épisodique dont on connait les désordres dans les états de stress traumatiques : intrusions, réminiscence, évitement, évènement occulté. Ces traces mnésiques participent à la mémoire collective et à l’identité sociale. Leur étude porte sur leur nature, leur maintien, leur transformation avec l’âge, les pathologies ou le temps. |
| 10h50-11h | Pause |
| 11h-11h35 | ♦ Anne Raulin (anthropologue, Université Paris Nanterre, AnthropoVilles) « ''Villes blessées'' : au lendemain du 11 septembre 2001 ». La notion de « ville blessée », apparue après les attentats du 11 septembre 2001 à New-York (en parallèle de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse), interroge la dimension de la vulnérabilité urbaine et la manière dont elle peut affecter les perceptions que les habitants ont de leur ville. À partir de ses terrains à New York, Anne Raulin a observé que ce désastre a suscité, en plus des représailles militaires, des mouvements de réconciliation entre populations touchées, mouvements et initiatives qui ont porté des projets de reconstruction communs vécus comme autant de formes de réparation symbolique. Les entretiens rassemblés par Columbia University dans le September 11 Oral History Project permettent enfin de prolonger cette réflexion en révélant combien la destruction urbaine est éprouvée aussi bien dans les corps que dans les espaces publics et ce qui fait mémoire dans les expériences |
| 11h35-12h10 | Discussions |
| 12h10-14h | Pause repas |
Expériences dans un contexte de catastrophePrésidence de séance : Spyros Franguiadakis (sociologue, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber)
|
|
| 14h-14h35 | ♦ Damienne Provitolo (géographe, directrice de recherche au CNRS, co-directrice de l'équipe RISQUES, directrice adjointe scientifique de l’Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement durable d’Université Côte d’Azur) « Les comportements humains durant les catastrophes soudaines et brutales : unicité ? Diversité ? » Lors d’une catastrophe, la panique n’est pas le seul comportement : les réactions des populations restent encore mal connues, alors qu’elles sont essentielles pour renforcer la résilience et sauver des vies. Beaucoup ignorent comment se protéger. S’appuyant sur les recherches menées par le programme Com2SiCa, Damienne Provitolo montrera la diversité des conduites possibles, face à des catastrophes naturelles, technologiques ou sociétales : certaines « adaptées », d’autres « inappropriées » (sidération, fuite vers le danger, curiosité), en décalage avec les réactions attendues par les dispositifs institutionnels. |
| 14h35-15h10 |
♦ Christelle Casse (ergonome, maîtresse de conférences en ergonomie à l’Institut d’études du travail de Lyon (IETL) de l'Université Lumière Lyon 2 et à EVS) S’appuyant sur des travaux portant sur la gestion des événements en tunnel routier (comme la catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc de mars 1999) et sur les comportements d’auto-évacuation, Christelle Casse analysera les dynamiques réelles d’évacuation lors d’incendies, d’explosions ou d’exercices de sécurité à grande échelle. L’observation et le recueil de témoignages d’usagers impliqués dans des situations réelles ou simulées révèlent que, contrairement aux représentations courantes, ils ne quittent pas spontanément leur véhicule face au feu, à la fumée ou à une explosion. Leurs perceptions, représentations et stratégies, souvent marquées par l’attente, et mettent en évidence les décalages par rapport aux dispositifs de sécurité classiques. |
| 15h10-15h45 | ♦ Sandrine Teixido (anthropologue, membre du Laboratoire d’Anthropologie Prospective, Université Catholique de Louvain) « Les mémoires vives des inondations à Porto Alegre (Brésil) ». Communication en visio-conférence depuis le Brésil L’intervention de Sandrine Teixido portera sur la reprise d’un terrain mené à Porto Alegre, autour de la mémoire des inondations, à dix ans d’intervalle. En 2013, elle avait étudié les crues de 1941 et 1967 à travers une approche historique, anthropologique et artistique, en lien avec les grandes infrastructures mises en place pour protéger la ville contre les eaux du lac Guaíba. Son enquête lui avait permis de recueillir des témoignages variés, de pêcheurs, de citoyens, d’activistes ou encore d’ingénieurs. En mai 2024, de nouvelles pluies torrentielles inondent Porto Alegre et le Rio Grande do Sul, révélant l’inefficacité des dispositifs construits. Le programme « Resgate de memórias », lancé par le centre de recherches visuelles de l’Université du Rio Grande do Sul, accompagne alors les victimes dans la récupération d’objets et de photos à valeur affective. Sandrine Teixido mettra en regard ces deux périodes marquées par des représentations contrastées du fleuve et de la maîtrise des crues. |
| 15h45-16h | Pause |
| 16h-17h30 | Synthèse de Anne Raulin et discussion générale animée par Mouloud Boukala (anthropologue, Université du Québec à Montréal, CELAT) |
Informations pratiques
Lieu(x)
Campus Berges du Rhône
Amphithéâtre Benveniste - Maison de l’Orient et de la Méditerranée
3, rue Raulin 69007
3, rue Raulin 69007
Partenaires