À 39 ans, Keltoume Larchet, adjointe au chef de la Division de la recherche criminologique à la Direction nationale de la police judiciaire, a soutenu le 4 décembre 2024 sa thèse de sociologie, "Les fabriques des chiffres sur les criminalités. Une sociologie mise en pratique", dans le cadre d'une validation des acquis de l'experience (VAE), qui s'appuie sur 9 années d'expérience professionnelle de recherche en dehors du monde académique. Rencontre avec une toute nouvelle docteure en sociologie au profil atypique et passionnant.
Portrait de Keltoume Larchet
- Son cursus universitaire initial et son parcours professionnel
-
K. L. : « Après l'obtention en 2008 d’un master de sciences sociales à l'université de Reims Champagne Ardenne, j'ai entrepris pendant 5 ans une thèse de sociologie à l'ENS de Cachan, sans toutefois la mener à terme. En parallèle, j'ai enseigné à l'université de Reims (2007-2011) et à l'ENS de Cachan (2011-2013).
Par la suite, j'ai occupé différents postes dans des institutions publiques. J'ai ainsi travaillé au sein d'un service budgétaire d'une administration centrale au ministère de l'Agriculture, avant d'être embauchée en 2015 à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) qui dépendait des services du Premier ministre, et plus spécifiquement de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Au sein de cet observatoire, j’étudiais notamment les violences physiques, les menaces, les insultes discriminatoires, les homicides volontaires, les groupes à risque délinquant… à partir d’enquêtes de victimation et de données opérationnelles collectées au sein de services de police.
À la fermeture de l'ONDRP en 2020, j'ai été embauchée par la Direction centrale de la police judiciaire (devenue depuis Direction nationale de la police judiciaire) pour participer à la création d'un service de recherche et d'analyse criminologique. Au sein de ce service, nous construisons et exploitons des données quantitatives à partir d’informations opérationnelles, dans la perspective d’analyser des phénomènes criminels relevant du spectre des atteintes graves aux personnes. » - Son projet de thèse et sa réalisation par la VAE
-
K. L. : « J'ai construit un projet de thèse autour des pratiques de quantification de la criminalité que j’étais amenée à réaliser depuis près d’une dizaine d’années, en ciblant plus spécifiquement mon propos autour de mises en œuvre pratiques de quantification : les insultes sexistes et les homicides volontaires, les premières étant adossées à une analyse statistique textuelle réalisée à partir de champs ouverts d'enquêtes de victimation et les seconds à partir de données opérationnelles de la police judiciaire.
La particularité de la VAE en doctorat renvoie au fait que le matériau de la thèse repose sur la pratique professionnelle du candidat. La recevabilité de la candidature est soumise au fait de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle de recherche et de la participation à des travaux scientifiques, de publications et de communications. À l’issue de la recevabilité du dossier, le format en VAE implique la rédaction d’un manuscrit original (ce qui diffère de thèses dites « sur travaux ») et se conclut par une soutenance devant un jury (obéissant aux mêmes règles que celles suivies lors d’une thèse non réalisée en VAE). » - Son retour d'expérience sur le processus de VAE
-
K. L. : « Lorsque j'ai envisagé de me relancer dans la réalisation d'une thèse, j'ai pris connaissance de la possibilité d'effectuer une thèse en VAE et me suis renseignée. Via des échos de mon réseau et compte tenu de la grande réactivité des services de l'Université Lumière Lyon 2, il m'est apparu pertinent de m'inscrire au sein dans un établissement aussi engagé sur des enjeux de formation continue et de démocratisation de la reconnaissance académique des savoirs.
Que ce soit en amont de la phase préparatoire du projet, ou encore au cours de la conduite de la thèse, j’ai pu disposer d’un accompagnement optimal et singularisé. Sur le plan administratif, j’ai ainsi pu bénéficier de renseignements précis et circonstanciés de la part du service commun de la formation continue sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du dispositif au sein de l’université Lumière Lyon 2. L'ensemble des interlocuteurs et interlocutrices que j'ai pu avoir, au Service commun de la formation continue et à la Direction de la recherche et des écoles doctorales, m'ont apporté leur aide et ont fait preuve d'une grande implication en composant avec les incidences de ce nouveau format (qu'il s'agisse de la temporalité resserrée de l'exercice, des modalités spécifiques de financement, ou encore de mon statut professionnel à temps plein en parallèle de celui de doctorante).
Sur le plan méthodologique et scientifique, l’accompagnement dont j’ai pu bénéficier pour consolider mon projet et rédiger le manuscrit a été déterminant et conséquent. Je souligne à cet égard l’implication de mon directeur de thèse, Bruno Milly, qui m’a encadrée avec minutie, une grande disponibilité et dans une démarche de dialogue particulièrement enrichissante. Je souligne également le rôle de Bertrand Ravon en amont de mon inscription, avec lequel j’ai eu la chance d’échanger pour construire un projet de thèse viable au moment où cette dernière était en gestation. »
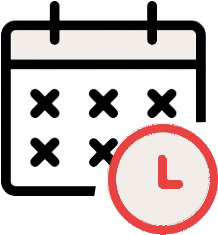 Thèse rédigée en 13 mois, Thèse rédigée en 13 mois,s’appuyant sur 9 ans d’expérience professionnelle de recherche en dehors du monde académique, en tant que contractuelle de la fonction publique. |
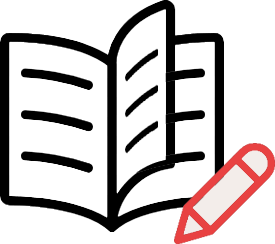 525 pages 525 pages→ 6 chapitres structurés en 3 parties → Une bibliographie de 22 pages → La thèse comporte 29 graphiques et figures, 22 encadrés ainsi que 17 schémas. |
Bruno Milly, directeur de l'école doctorale Sciences Sociales (ED 483) et directeur de la thèse de Keltoume Larchet, se réjouit : « C'est une très belle première pour l'Université Lumière Lyon 2, pour l'ED Sciences Sociales et pour le Centre Max Weber. Le jury a été dithyrambique et salué la grande qualité de cette thèse. Celle-ci constitue une réflexion sur une sociologie mise en pratique pendant dix ans au sein de différents services des services du Premier ministre et de la Police Judiciaire. On peut même la considérer comme un très bon polar où l'on découvre ce qu'il advient en chiffres des actes identifiés comme criminels (les homicides par exemple) ! Et pour les sociologues, c'est un travail qui fera référence pour la sociologie de la quantification et de la statistique publique, ainsi que pour la sociologie des criminalités et la dite "criminologie". »
Keltoume LARCHET, entourée par les 5 membres de son jury de soutenance :
| ♦ Marion GUENOT, Chargée de recherche, CNRS, CESDIP (UMR 8183), Examinatrice ; ♦ Emmanuelle LECLERCQ, Professeure des universités, Université de Reims Champagne-Ardenne, CEREP (UMR 5116), Rapportrice ; ♦ Bruno MILLY, Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber (UMR 5283), Directeur de thèse ; ♦ Jérôme PÉLISSE, Professeur des universités, Sciences Po Paris, CSO (UMR 7116), Rapporteur ; ♦ Bertrand RAVON, Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, Centre Max Weber (UMR 5283), Président du jury. |
 de gauche à droite : Marion Guenot, Jérôme Pélisse, Keltoume Larchet, Bruno Milly,
de gauche à droite : Marion Guenot, Jérôme Pélisse, Keltoume Larchet, Bruno Milly,Bertrand Ravon et Emmanuelle Leclercq.
- Résumé de sa thèse "Les fabriques des chiffres sur les criminalités. Une sociologie mise en pratique"
-
Prenant comme matériaux la pratique professionnelle de mesure des criminalités que nous exerçons dans deux institutions depuis une dizaine d’années, cette thèse en validation des acquis de l’expérience (VAE) analyse cette mesure comme la fabrique de chiffres qui tiennent plus ou moins solidement. Une telle thèse revient à mettre à distance aussi bien l’idée selon laquelle les chiffres de la criminalité seraient vrais de façon objective et définitive, que l’idée selon laquelle ces chiffres seraient arbitraires au point qu’on pourrait leur faire dire tout et son contraire.
Prenant appui sur les résultats de la sociologie de la quantification telle qu’Alain Desrosières, entre autres, l’a définie et travaillée, la thèse endosse la conception selon laquelle les chiffres sont construits, dans leur rapport à la réalité qu’ils mesurent, de façon plus ou moins solide ; ce qui revient à les analyser aussi depuis les dynamiques de critiques et de controverses dans lesquelles ils peuvent être pris. La première partie porte ainsi un regard macro sur la quantification des criminalités en France. Elle revient sur la dynamique des critiques ayant conduit d’une mesure prenant appui sur les données institutionnelles à une mesure prenant appui sur une diversité de sources, la question du chiffre noir ayant été centrale dans l'élaboration de nouveaux instruments de mesure comme le sont les enquêtes de victimation.
La deuxième partie porte un regard méso sur les organisations dans lesquelles nous avons travaillé. Elle analyse les différences voire les divergences dans les manières de quantifier les criminalités existant, depuis notre point de vue, entre l’institution policière, la criminologie, la statistique publique et la sociologie. La troisième partie porte un regard micro sur nos pratiques de quantification. Elle explicite les supports que nous avons mobilisés pour tenter de faire tenir les chiffres concernant deux phénomènes particuliers : les insultes, à partir d’une analyse statistique textuelle d’enquêtes de victimation, et les homicides volontaires, à partir de données opérationnelles de Police judiciaire. Analyser ces dynamiques diverses de fabrique des chiffres des criminalités conduit finalement à éclairer quatre opérations permettant d’évaluer le degré de solidité d’un chiffre et d’ainsi le rendre discutable : la catégorisation du phénomène, l’identification des sources les plus adéquates à la réalité étudiée, le codage comme mise en variables et le codage comme collecte.
→ En savoir plus
Informations pratiques

Crédits photos
© Direction de la recherche et des écoles doctorales (DRED) & Direction Sciences et société (DiSS) - Service commun de la formation continue (SCFC)




